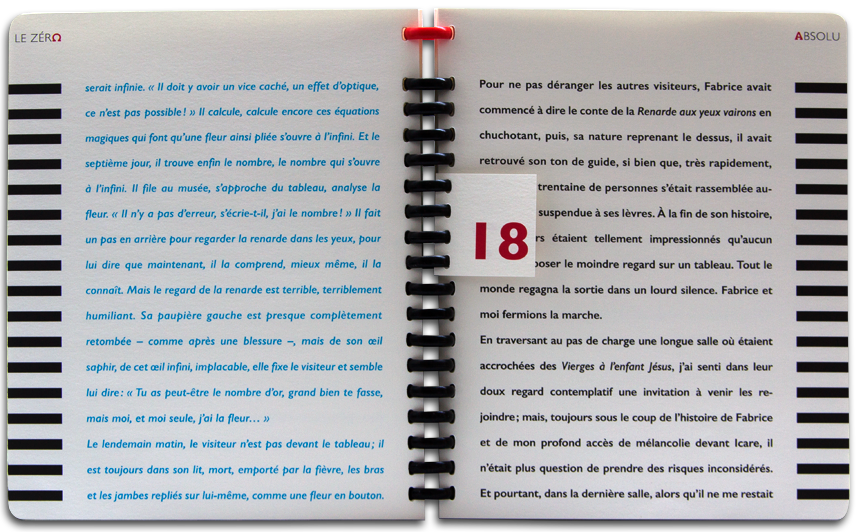
Vous qui êtes sur le point de me suivre au creux de ces lignes, sachez qu’elles s’égarent dans le dédale d’un récit profondément confus. Parfois, peut-être, pourra-t-il vous paraître presque clair, et alors vous sentirez se réduire la distance qui nous sépare, mais à d’autres moments, le fossé grandira. Cela ne veut pas dire que nous appartenions à des mondes différents, cela signifie qu’il y a un monde entre nous.
À l’origine pourtant, les choses étaient si simples. Il n’y avait ni fossé, ni barrière. À l’arrière de notre maison à la campagne, sur les hauteurs de Spa, le jardin s’ouvrait directement sur un bois de bouleaux que son propriétaire n’avait pas jugé utile de clôturer. C’était mon paradis. Il était juste assez grand pour s’y perdre, juste assez petit pour s’y retrouver. Durant mon enfance, j’y passais des journées entières. Les couleurs du bois étaient nettes : les troncs noirs et blancs, les hautes herbes vertes, les fleurs bleues. En automne, les feuilles devenaient dorées.
Les hivers de chance, la neige rendait le paysage tout blanc.
Puis un jour que je n’oublierai jamais, j’ai remarqué un gros point rouge sur un tronc, puis sur un autre, puis sur une dizaine d’autres. J’ai demandé à ma mère ce que cela signifiait.
« C’est un peintre qui a fait ça.
— Ah bon, c’est joli ! »
Ces points formaient d’élégantes petites touches décoratives qui s’accordaient parfaitement avec le blanc et noir des troncs. Mais quand on les regardait plus attentivement, on ne voyait plus qu’eux. Ils envahissaient complètement notre champ de vision.
Le lendemain, j’ai eu la chance de tomber sur le peintre. Il poursuivait son œuvre sur d’autres troncs. Je voulais en savoir plus.
« Pourquoi ce tronc plutôt qu’un autre ?
— Je choisis les plus gros, ceux avec lesquels on fera les plus beaux meubles.
— Les plus beaux meubles ? !
— Oui, ces bouleaux sont destinés à devenir des meubles. Ils arrivent à maturité. Ce printemps, nous coupons un premier lot. L’an prochain, ils auront tous disparu. »
J’ai quitté le bois en courant.
« Maman, tu m’as menti. Tu m’as dit que c’était un peintre. Tu savais très bien qu’il marquait les arbres pour les couper.
— Mais ce n’est pas antinomique avec la fonction de peintre. Les peintres n’ont jamais eu peur de signaler la catastrophe. Pense à la Chute d’Icare, le tableau de Bruegel. Alors que les personnages représentés travaillent calmement aux champs, un tout petit point coloré à la surface de la mer indique qu’Icare est en train de s’y noyer. Personne, à part le peintre, ne se soucie de lui. Et pourtant, dès que l’on a repéré ce minuscule point dans le tableau, on ne voit plus que lui. »
Plus tard, lorsque mon bois a été définitivement rayé de la surface de la Terre, j’ai tenté de retrouver son esprit en me plongeant dans la lecture. Dès qu’un roman se passait dans la forêt, je le lisais. Si certains récits sont parvenus à me consoler un moment, parfois même à enrichir les impressions que j’avais conservées de mes promenades sous les bouleaux, je n’ai pourtant jamais réussi à me reconstituer une vision véritablement claire de ce qu’avait été mon bois. Quand je fermais les yeux et que je pensais très fort à lui, il n’apparaissait plus qu’à travers un épais brouillard. La forêt des brumes a fini par devenir le nom que j’ai donné à une sorte d’image impossible, une image de l’enfance disparue qui jamais plus ne se donnera à nous.
Je restais des journées à lire, enfermé dans ma chambre. Certains soirs, quand nous passions le week-end à la maison de campagne, je descendais regarder la télévision au salon. Depuis quelques années, nous maintenions en vie un vieux poste de télévision particulièrement capricieux dont les antennes réclamaient qu’on les règle sans cesse pour espérer y voir quelque chose de plus ou moins net. C’était justement cela que j’aimais dans cette télévision : elle diffusait des images toujours un peu troubles, parfois même fantomatiques, qui rendaient la moindre prise de vues aussi brumeuse que le souvenir de ma forêt.
Un soir, on donnait à la télévision l’adaptation cinématographique du Grand Meaulnes, le roman qui s’était le plus approché de « l’esprit » de mon bois. J’attendais beaucoup de ce film. Car si, lors du tournage, le réalisateur avait pu trouver une vraie forêt à la hauteur des mondes mystérieux
de mon héros, alors moi aussi, je pourrais découvrir, quelque part sur Terre, l’équivalent de mon bois de bouleaux.
Au moment où, dans le film, le Grand Meaulnes s’enfonce dans les bois, la mauvaise qualité de la diffusion faisait apparaître des ombres qui correspondaient exactement au souvenir que j’avais gardé de mon bois. Malheureusement, mon frère, comme s’il ne voyait pas assez bien, s’est précipité sur les antennes pour leur faire un sort. L’image a disparu. Désemparé, je me suis levé pour rétablir les antennes. En vain. J’ai secoué le poste de plus en plus fort. Mes parents ne comprenaient pas ma réaction. Mon frère riait de me voir aussi agité. Mais lorsque la télévision a commencé à fumer, tout le monde s’est calmé. L’écran ne répondait plus à rien. Le lendemain, notre voisin électricien a posé un diagnostic sans appel : notre poste de télévision était bel et bien mort.
Je m’en voulais terriblement. Mon père me disait que ce n’était pas grave, que c’était le destin de toute chose – même des objets – de disparaître un jour, qu’il irait très prochainement chercher un nouvel appareil plus fiable. Mais j’étais inconsolable. Je lui demandai de tout faire pour sauver ce poste, de ne pas se contenter du jugement d’un simple électricien, de faire appel à un spécialiste. C’était notre premier poste, il était irremplaçable, nous l’avions acheté spécialement pour voir les premiers pas de l’Homme sur la Lune. Nous avoir donné la chance de vivre en direct l’événement le plus important de l’histoire de l’humanité méritait tout de même un peu plus de considération.
Mon frère riait aux éclats. « Mais tu ne les as même pas vus ces premiers pas, ça se passait à trois heures du matin et tu étais si jeune à l’époque que tu dormais à poings fermés dans le canapé. » J’ai crâné. « Si tu passais ton temps à me regarder dormir dans le canapé, tu n’as pas pu les voir non plus. »
Au fond de moi, j’étais effondré. Mon frère avait sans doute raison. Même si j’étais persuadé d’avoir assisté à l’alunissage en direct, mes souvenirs restaient très vagues. Les quelques taches blanchâtres gravées dans ma mémoire étaient en réalité bien plus proches de la neige parasite de notre télévision que d’un authentique paysage lunaire.
C’était la toute première fois que je prenais véritablement conscience de mon penchant à bâtir ma réalité du monde sur des illusions. Je vivais parmi les ombres. L’ombre d’un bois disparu dans lequel je m’imaginais avoir été pleinement heureux, l’ombre d’un événement historique majeur devant lequel j’avais fermé les yeux.
Mes parents s’inquiétaient de me voir replié au fond de ma chambre. À la fin de mes humanités, ils m’ont poussé à poursuivre mes études à Paris. « Le bouillonnement de la ville te ramènera à la surface de la vie réelle » disait mon père.
Pour rester encore un peu dans mes pensées, j’ai fait le trajet à pied. J’ai rejoint le bois de Saint-Rémy dans les Ardennes, là où l’on venait de retrouver le corps d’Alain-
Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes. Puis j’ai fait route jusqu’à Charleville. J’y ai acheté une carte retraçant le premier voyage de Rimbaud à Paris. Je me suis mis dans ses pas. Les chemins de campagne qu’il avait empruntés s’étaient transformés en départementales réfractaires aux piétons.
À Paris, rien n’a pu me faire oublier ma forêt des brumes. Quand la nostalgie était trop forte, j’allais au cimetière du Père-Lachaise et je marchais de longues heures au milieu des arbres et des disparus. Un jour, je me suis glissé dans un groupe qui suivait une visite guidée passionnante. Le guide passait de tombe en tombe, décrivant avec une extrême précision les plantes qui poussaient entre deux pierres, les espèces d’insectes ou de petits rongeurs qui vivaient dans une anfractuosité ; il expliquait leurs comportements, leurs moyens de survie. À aucun moment, il n’évoquait les morts environnants, même les plus célèbres. Et pourtant, on ne pouvait s’empêcher de penser à eux. Il se dégageait même de la visite un étrange sentiment d’harmonie entre la nature et les disparus. Comme si la flore et la faune avaient fini par s’accorder avec la façon dont ils avaient vécu, dont ils étaient morts. Le guide s’appelait Fabrice. Pendant un mois, j’ai suivi ses visites deux fois par semaine. Je ne m’en lassais pas. Nous avons sympathisé. Au terme d’une visite particulièrement intense, j’ai demandé à Fabrice comment il s’y prenait pour si bien nous faire ressentir la force de nos destinées dans le grand mouvement de l’Univers.
Le poids de ma question ne semblait pas du tout l’écraser. Il m’a répondu : « Mais tout simplement parce qu’il n’y a ni destinée ni grand mouvement de l’Univers. Il n’y a aucun sens à la vie. Il n’y a pas de loi de la Nature. Je ne décris que ce que je vois, je ne prête aucune intention. Dans ce vide de sens, je laisse aux autres le soin d’y déposer tout ce qu’ils veulent.
— Peut-être devrais-je accepter moi aussi de voir ma vie se résumer au fait de placer tous mes rêves et mes espoirs dans des situations vides de sens. Mais si je devais en arriver là, ce serait uniquement parce que j’ai été coupé de mes racines. Si j’avais pu grandir dans mon bois, je suis sûr que j’y aurais trouvé les vraies lois de la Nature.
— Ne te leurre pas. Tes racines ne sont pas dans ton bois, mais dans le fait de l’avoir perdu. Tes racines sont dans le mythe du paradis perdu. Ce n’est pas mal d’ailleurs de se construire autour de ce mythe. C’est plus réconfortant de croire que l’on a perdu ce qu’en réalité on n’a jamais réussi à atteindre. Tu préfères te dire que tu as perdu la vérité qui se cachait dans ton bois, plutôt que d’admettre la réalité : tu ne connaîtras jamais cette vérité pour la bonne et simple raison qu’elle n’existe pas. »
Nous ne nous sommes plus revus pendant plusieurs mois. Puis un jour, Fabrice m’a envoyé par la poste une invitation pour une exposition au Grand Palais. Elle était intitulée Le mythe du paradis perdu dans la peinture des maîtres de l’Europe du Nord, de Jan van Eyck à Albrecht Dürer. En bas du carton, un petit mot de la main de Fabrice disait : « Voilà une bonne occasion de me faire découvrir tes racines ! »
Le jour convenu, nous nous retrouvions au Grand Palais.
Dans la première salle de l’exposition, avaient été accrochés les tableaux relatifs aux Jardins d’Éden ; au cœur de forêts imaginaires, on y voyait vivre en parfaite harmonie des lapins, des ours, des loups et des licornes.
La salle suivante abordait le thème de la Chute. J’ai tout de suite repéré la Chute d’Icare de Pieter Bruegel. C’était la première fois que je la voyais en vrai. Le petit point de couleur représentant Icare tombé à l’eau m’hypnotisait. Je ne parvenais pas à m’en détacher. Je m’enfonçais même dans l’idée terrifiante que j’étais cet Icare, cet être chargé des rêves les plus fous en train de se noyer dans un océan de non-sens.
Fabrice est venu vers moi. Il remarquait à quel point j’étais blême. « Excuse-moi, je ne pensais pas que cette exposition allait te faire un tel effet. Viens, allons-nous-en ! » Mais j’étais devenu prisonnier du tableau. Icare m’entraînait dans une chute qui m’apparaissait aussi effrayante qu’enivrante.
Fabrice m’a pris par le bras. « Viens ! » Je l’ai suivi presqu’à reculons, les yeux toujours rivés sur le tableau. « Viens ! » Pour me calmer, Fabrice m’a entraîné devant une petite toile de Dürer représentant un lièvre debout dans un champ de fleurs. Petit à petit, je suis revenu à moi. J’ai murmuré : « Mais que s’est-il passé avec ce tableau ? » Alors Fabrice, bien campé devant le lièvre, m’a raconté l’histoire de la Renarde aux yeux vairons. C’était un conte particulièrement apprécié des Romantiques allemands.
Dans une salle mal éclairée du Musée d’Histoire Naturelle de la ville universitaire de Heidelberg, aux portes de la Forêt-Noire, un visiteur de passage dans la région s’arrête devant un petit tableau représentant une renarde aux yeux vairons. Son œil gauche est couleur d’or, son œil droit bleu saphir. Le visiteur est attiré par le regard étrange de la renarde. Rien dans le tableau ne donne d’indice permettant de savoir si la renarde est aux abois, cernée par les chiens des chasseurs, ou, au contraire, si elle est prête à sauter sur une proie (un petit lapin par exemple) qui ne peut lui échapper. C’est un regard où l’on sent qu’il est question de vie ou de mort, un regard d’une très grande profondeur. La renarde semble prendre le spectateur du tableau à témoin : « Viens, viens me sauver, tout de suite, sinon il sera trop tard ! » ou bien « Va-t’en, tu n’as rien à faire ici. Attention, après le lapin, c’est sur toi que je vais sauter et, méfie-toi, je suis enragée. »
Le visiteur retourne à son hôtel. Le lendemain matin, avant de poursuivre son voyage, il passe au musée pour aller revoir la renarde. Cette fois, il comprend son regard : elle va se faire tuer par les chasseurs, il n’y a pas d’issue. Le visiteur reste des heures devant le tableau, pétrifié, comme si le fait de se tenir là maintenait les crocs des chiens à bonne distance de la pauvre bête. À la fermeture du musée, il rentre à son hôtel. Le lendemain, à la première heure, il se précipite devant le tableau. « Non ! » Il s’était trompé de regard, elle est prête à bondir sur sa proie. « Je dois l’en empêcher ». Et il reste là pour défendre l’hypothétique petit lapin. Ainsi va sa vie : un jour il prend en pitié la pauvre renarde aux yeux vairons, le lendemain il la hait. Cette image le rend complètement fou. « Comment sortir de ce cercle vicieux ? » Il apprend que le peintre de ce tableau vit, reclus, dans un petit village au cœur de la forêt. Le visiteur part à sa rencontre. Lorsqu’enfin, il déniche sa tanière, il lui fait part de son émoi. Tout de suite, à voir le sourire malicieux du vieux peintre, le visiteur comprend son erreur, jamais il ne connaîtra la vérité. Le vieux peintre dit seulement : « Ne vous approchez pas trop près de ma renarde. Restez à votre place, celle d’un visiteur, celle d’un amateur occasionnel de peinture. »
Sur le chemin du retour, le visiteur est épuisé. Il en a assez ; il ne veut plus rentrer dans ce jeu qui finalement n’a absolument aucun sens. Il passera une dernière nuit à son hôtel, puis il reprendra son voyage et oubliera la renarde une fois pour toutes.
Le lendemain, il va lui dire adieu. Devant le tableau, il découvre un homme, un homme immobile qui, lui aussi, contemple la renarde aux yeux vairons. Ne supportant pas cette présence, le visiteur fait les cent pas dans les autres salles du musée sans vraiment porter attention aux objets exposés, puis, après une heure, revient devant le tableau. L’homme est toujours là, dans la même position. Comme à l’arrêt. Le visiteur est pris d’une terrible jalousie, il est presque prêt à se jeter de rage sur l’homme. Mais il parvient à se contenir et rentre à son hôtel. Le lendemain, il se précipite au musée. L’homme est déjà là. Le visiteur, à sa grande surprise, ne ressent plus la moindre jalousie pour l’homme. Au contraire, il est pris d’une grande pitié. Il a envie de lui dire : « Attention, ne reste pas là, cette image est dangereuse, pars si tu en as encore la force. »
L’homme est tellement absorbé par le tableau qu’il ne se rend même pas compte du visiteur dans son dos. Tous les deux ne sortent qu’à la fermeture du musée. Sur le pas de la porte, le visiteur propose à l’homme de faire connaissance.
Ils dînent ensemble. Aucun des deux n’ose évoquer le fameux tableau. Ils parlent de leur métier. Le visiteur est un mathématicien à la recherche d’un emploi dans une université. L’homme est botaniste. Un botaniste qui, au grand soulagement du visiteur, partira dès le lendemain pour un long voyage d’exploration autour du monde. Ils se disent au revoir.
Le lendemain, le visiteur va retrouver sa renarde. Rien que pour lui. Ainsi, de jour en jour, de peur en réconfort, d’amour en rejet, les sentiments mélangés du visiteur deviennent de plus en plus profonds.
Après quelques mois, en quittant son hôtel pour aller au musée, le visiteur se fait remettre une lettre par le gardien de l’hôtel. Elle a été envoyée par l’homme parti autour du monde. Il lui écrit : « Je n’ai pas trouvé “la fleur bleue”. J’ai tout tenté, mais en vain. La seule chose que m’a donnée mon voyage, ce sont les fièvres qui aujourd’hui m’emportent. Quand vous lirez cette lettre, je ne serai déjà plus. Adieu l’ami, et bonne chance. »
Cette mystérieuse lettre pliée dans sa poche, le visiteur va au musée. Il s’approche de la renarde. Comme il ne l’a encore jamais fait. Il se trouve à quelques centimètres seulement de son œil bleu. Et il comprend. Cet œil, cet œil bleu saphir représente en réalité une fleur, une minuscule fleur en bouton. Elle est peinte avec une infinie délicatesse ; comment le poil d’un pinceau a-t-il pu peindre des traits aussi fins ? Elle n’est pas encore éclose. Elle paraît si fragile. Le moindre coup de vent pourrait la faire disparaître. Et pourtant, une force irrésistible semble habiter cette fleur. Le visiteur s’approche encore, parvient à déceler le moindre pli du moindre pétale à venir. Il essaie d’imaginer à quoi ressemblerait cette fleur si elle parvenait à éclore. Mais il ne le peut pas. Son imagination est trop petite. Au dos de la lettre de son ami, il dessine les plis de la fleur en bouton. Puis il rentre à son hôtel. Il y restera une semaine, sans dormir, sans sortir ; une semaine à calculer l’ouverture des plis. Petit à petit, il comprend que cette fleur, si jamais elle parvenait à s’ouvrir, serait infinie. « Il doit y avoir un vice caché, un effet d’optique, ce n’est pas possible ! » Il calcule, calcule encore ces équations magiques qui font qu’une fleur ainsi pliée s’ouvre à l’infini. Et le septième jour, il trouve enfin le nombre, le nombre qui s’ouvre à l’infini. Il file au musée, s’approche du tableau, analyse la fleur. « Il n’y a pas d’erreur, s’écrie-t-il, j’ai le nombre ! » Il fait un pas en arrière pour regarder la renarde dans les yeux, pour lui dire que maintenant, il la comprend, mieux même, il la connaît. Mais le regard de la renarde est terrible, terriblement humiliant. Sa paupière gauche est presque complètement retombée – comme après une blessure –, mais de son œil
saphir, de cet œil infini, implacable, elle fixe le visiteur et semble lui dire : « Tu as peut-être le nombre d’or, grand bien te fasse, mais moi, et moi seule, j’ai la fleur… »
Le lendemain matin, le visiteur n’est pas devant le tableau ; il est toujours dans son lit, mort, emporté par la fièvre, les bras et les jambes repliés sur lui-même, comme une fleur en bouton.
Pour ne pas déranger les autres visiteurs, Fabrice avait commencé à dire le conte de la Renarde aux yeux vairons en chuchotant, puis, sa nature reprenant le dessus, il avait retrouvé son ton de guide, si bien que, très rapidement, une bonne trentaine de personnes s’était rassemblée autour de lui, suspendue à ses lèvres. À la fin de son histoire, ces visiteurs étaient tellement impressionnés qu’aucun n’osa plus poser le moindre regard sur un tableau. Tout le monde regagna la sortie dans un lourd silence. Fabrice et moi fermions la marche.
En traversant au pas de charge une longue salle où étaient accrochées des Vierges à l’enfant Jésus, j’ai senti dans leur doux regard contemplatif une invitation à venir les rejoindre ; mais, toujours sous le coup de l’histoire de Fabrice et de mon profond accès de mélancolie devant Icare, il n’était plus question de prendre des risques inconsidérés. Et pourtant, dans la dernière salle, alors qu’il ne me restait
plus qu’une dizaine de mètres à accomplir, je me suis arrêté net. Une force inconnue me retenait là, bouche ouverte, les yeux écarquillés.
« Ah ! non ! tu ne vas pas recommencer, me disait Fabrice, visiblement agacé par mon comportement. Qu’est-ce que tu as bien pu voir dans cette salle ? Elle est totalement vide, regarde, il n’y a pas le moindre tableau. »
De fait, les murs de la salle étaient nus. Peints d’un blanc parfait. Un blanc d’une profondeur incroyable. Contrairement à l’angoisse qui m’avait étreint devant la Chute d’Icare, la présence de ce blanc me comblait. C’était comme si j’avais été soudainement transporté dans mon bois de bouleaux, un matin d’hiver, quand la neige tombée silencieusement la nuit donne l’impression de pénétrer dans un monde lunaire. Dès que j’ai retrouvé mes esprits, je me suis dirigé à l’entrée de la salle où se trouvait un petit carton explicatif. Ces murs rendaient hommage à un aspect totalement méconnu de la peinture religieuse d’Europe du Nord. Ils avaient été peints en « Blanc Absolu ». C’était le nom que l’on donnait à un blanc très précis qui avait été utilisé à la naissance du protestantisme pour repeindre les murs des églises, après les avoir dépouillés de toute forme d’image. Le moindre tableau était en effet suspect d’être source de mensonge. Cette couleur blanche – dont la composition avait été gardée secrète pendant des siècles – était si intense, si froide qu’elle donnait au fidèle l’impression de pénétrer dans un lieu d’une vérité absolue.
Je m’étais placé au centre de la salle et ne savais où donner de la tête, où poser le regard pour commencer à m’imprégner de ce blanc absolu. Fabrice n’avait plus eu la patience de me répéter : « Allez viens ! » Il m’avait laissé tout seul.
À vrai dire, je ne me sentais pas complètement seul dans cette salle. Depuis mon arrivée, je ne pouvais m’empêcher de suivre les mouvements de mon ombre portée sur le mur. Elle constituait la seule touche foncée qui survivait dans cet environnement immaculé. Je me suis approché d’elle exactement comme, dans le bois enneigé de mon enfance, je m’approchais des troncs noirs les plus attirants et je mettais mes pieds dans leurs racines pour qu’ils deviennent mon ombre. Il m’arrivait de rester des heures devant un tronc comme la marâtre de Blanche-Neige devant son miroir. Dans l’air glacé, je lui demandais : « Qui es-tu ? » Puis je transformais ma voix pour qu’elle s’accorde aux formes de mon ombre géante et je me lançais dans de longs dialogues avec les personnages fantastiques qui vivaient en moi.
L’heure de la fermeture du Grand Palais étant imminente, je devais être le dernier visiteur encore « en activité ».
Je me suis approché de mon ombre. Au début, j’y ai vu les contours d’un homme se dressant entre moi et le blanc des murs ; un homme tout droit sorti du conte de Fabrice. Sa présence m’insupportait. J’ai réussi à le chasser de mon esprit. Il a aussitôt fait place à la silhouette du peintre qui avait marqué autrefois les points rouges sur mes bouleaux.
Les images s’entrechoquaient dans ma tête, j’avais le tournis. Ma vision se troublait. Mes bras s’agitaient dans tous les sens, comme des antennes qui auraient voulu m’aider à y voir plus clair.
Je n’étais plus qu’à quelques centimètres du mur.
« Qui es-tu ? » ai-je chuchoté à mon ombre.
« Je suis Alain-Fournier, m’a répondu une voix d’outre-tombe.
— Je ne te reconnais pas, tu ne ressembles pas aux photos.
— C’est normal, on vient juste de me déterrer du fond des bois de Saint-Rémy. Je n’ai pas eu le temps de me changer.
Je suis envahi de racines noires qui m’ont troué les yeux, je ne te vois pas très bien, qui es-tu, toi ? » m’a demandé Alain-Fournier.
C’était la première fois qu’une ombre s’autorisait à me poser une telle question. J’étais complètement pris au dépourvu.
« Euh… moi… je… je suis le narrateur, comme dans Proust. Je suis le narrateur de l’histoire.
— Quelle histoire ?
— Ben… l’histoire dans laquelle nous nous trouvons.
— Tu veux dire que je viens d’entrer dans ton histoire ?
— Oui, si tu veux bien.
— Non, je ne le permets pas. Pour qui te prends-tu ? Qui es-tu ? Hein, qui es-tu ? Je te le demande. C’est toi qui fais partie de mon histoire. Je commence à te connaître. Avec tes états d’âmes, tes accès de mélancolie, tu n’es qu’une pâle excroissance de mon Grand Meaulnes. Est-ce que tu es au moins capable d’imaginer une vraie histoire, une histoire sortie de nulle part, sans devoir vampiriser les autres ? »
J’étais au pied du mur. Mon ombre s’était mise de côté. Devant moi se dressait un blanc absolu, froid, infini. Je me suis jeté à l’eau, jeté dans la première histoire qui s’est donnée à moi.
Quelque part sur la banquise, un squelette est assis sur un bloc de glace dans la position d’un penseur : coude sur le genou, main sous le menton. Venu de nulle part, un bonhomme de neige s’approche tout tremblant et lui prend l’autre main. « J’ai froid, j’ai terriblement froid ! dit-il au squelette.
— C’est normal que tu aies froid, tu es fait de neige. Avoir froid est constitutif de ton être. Tu n’aurais pas froid, tu ne serais plus ce que tu es.
— Ah bon ! » répond le bonhomme de neige. Ces paroles le soulagent, elles lui réchauffent le cœur. Ses grelottements cessent, il se laisse aller. Et sous les rayons du soleil de minuit, il commence à fondre. Bientôt, il ne reste plus de lui que quatre cailloux : deux noirs pour les yeux, un gris pour le nez, un blanc pour la bouche. Le squelette se lève, roule trois grosses boules de neige, les place les unes sur les autres, ramasse les cailloux et les enfonce dans la boule du dessus pour en faire un visage.
« J’ai peur, j’ai terriblement peur ! » murmure le nouveau bonhomme de neige. Mais cette fois-ci, le squelette ne dit rien, il ne veut pas le réconforter et provoquer une nouvelle fonte.
« J’ai peur, reprend le bonhomme de neige, je n’ose pas entreprendre mon voyage tout seul, accompagne-moi ! »
Le squelette, qui a sa vie de squelette devant lui, l’accompagne.
Au bout d’un temps infini, le bonhomme de neige s’arrête devant un œuf abandonné comme on en trouve quelquefois sur la banquise.
Le bonhomme de neige s’assoit dessus et le couve. « C’est bon, dit-il au squelette, maintenant tu peux me laisser. »
Le squelette retourne à son point de départ. Il s’est à peine assis sur son bloc de glace, qu’un tout vieux bonhomme de neige apparaît et lui prend la main.
« Je suis seul, je suis terriblement seul, sais-tu où est mon ami ? »
Le squelette est bien embarrassé. Que lui dire ? que son ami a fondu ? ou qu’il s’est renouvelé et couve actuellement un œuf de l’autre côté de la calotte glacière ? Le squelette décide de mener le nouveau venu jusqu’à l’œuf.
« Qu’est-ce que tu fais là ! crie le vieux bonhomme de neige à son ami en train de couver, ses petits yeux noirs perdus dans le vide. Tu sais bien que tout cela n’a aucun sens, tu ne feras jamais éclore cet œuf, tu es bien trop froid, reviens ! »
Les deux amis partent de leur côté. De loin, le vieux bonhomme de neige se retourne vers le squelette et lui crie : « Toi, couve l’œuf, tu en es capable. »
Le squelette s’assoit en position de penseur sur l’œuf : coude sur le genou, main sous le menton. Il se demande : « Mais qu’est-ce que tout ceci veut bien dire ? » Assis sur son œuf, il se pose cette question pendant un temps infini. Et puis un matin, il entend des craquements. Ce n’est pas la glace, c’est l’œuf qui éclôt. Il en sort… une histoire ! Une toute petite histoire à peine formée. Le squelette la prend au creux de sa main, se lève et marche jusqu’à son point de départ. Il s’assoit sur son bloc de glace, ouvre délicatement la main et voit apparaître un bonhomme de neige tout tremblant qui lui dit :
« J’ai froid, j’ai terriblement froid. » — Ah ! non ! s’emporte le squelette, pas encore toi ! Va-t’en et laisse-moi seul avec mon histoire. — Mais c’est moi ton histoire, ne me chasse pas, je suis ton histoire ! » dit le bonhomme de neige, avant de fondre sous la chaleur des larmes qui coulent de ses petits yeux noirs.
Et voilà, mon histoire venue de nulle part était repartie nulle part. Elle m’avait glissé entre les doigts.
Les lumières de la salle s’éteignaient progressivement et, avec elles, l’ombre d’Alain-Fournier. Un gardien m’a poliment accompagné jusqu’à la sortie. J’étais épuisé.
Dehors, je me suis assis sur un banc à l’ombre d’un arbre. Coude sur le genou, main sous le menton, je n’ai pensé à rien.
C’est étrange comme le fait de ne penser à rien nous donne de la densité. On se replie en une boule noire compacte qui tombe dans le vide et que rien ne peut retenir.
Qu’y a-t-il en bas ?
Tout en bas.
« Où es-tu, ma fleur bleue ? »
« Où es-tu, mon bois des brumes ? »
J’aurais tant voulu être capable de ne décrire que ce que je voyais, ne prêter aucune intention, être simplement là.
J’ai levé la tête en direction du Grand Palais. Puis j’ai lu à haute voix le texte inscrit sur la plaque de cuivre vissée à côté de la porte principale. « Le Grand Palais a été édifié à partir de 1897 pour l’Exposition universelle de 1900. Le vaisseau principal, d’une longueur de près de 240 mètres, est constitué d’un espace imposant surmonté d’une large verrière. La voûte en berceau légèrement surbaissée des nefs nord et sud et de la nef transversale, la coupole sur pendentifs et le dôme pèsent environ 8 500 tonnes d’acier, de fer et de verre. Le sommet de cet ensemble culmine à une altitude de 45 mètres. »
J’ai traversé le pont Alexandre III. « Inauguré pour l’Exposition universelle de Paris en 1900, le pont était le symbole de l’alliance conclue en 1891 entre l’empereur Alexandre III et le président de la République française Sadi Carnot. »
J’ai marché sous les marronniers du quai des Tuileries, sous les platanes du quai de la Mégisserie. Petit à petit, ma nature reprenant le dessus, je me suis enfoncé dans les rues, les sombres ruelles. Dans ce Paris crépusculaire, ce Paris chargé des fantômes du passé, j’ai fini par me perdre. Et, comme autrefois quand je me perdais dans mon bois de bouleaux, je me suis laissé emporter par des ombres aux pouvoirs magnétiques.
Je me suis mis dans les pas de Gérard de Nerval. Je l’ai accompagné jusqu’à la rue Basse de la Vieille-Lanterne. Puis j’ai suivi le Comte de Lautréamont jusqu’à sa petite chambre de la rue du Faubourg-Montmartre. Je me suis glissé dans la peau de Paul Celan jusqu’au pont Mirabeau. J’étais à deux pas de chez moi. J’étais revenu à la maison sans même en avoir eu l’intention, rien qu’en suivant des ombres froides. Mais bien entendu, même rentré chez moi, même roulé au fond de mon lit, je savais bien que je n’étais arrivé nulle part. Tout comme Nerval noué à une grille de la Vieille-Lanterne, Lautréamont étendu sur sa table de travail ou Celan juché sur la balustrade du pont Mirabeau ; ils n’étaient arrivés nulle part. Tout comme les chemins de mon bois ne m’avaient jamais mené nulle part, ne m’avaient jamais donné aucun sens.
Le lendemain, j’écrivais à Fabrice. Je lui disais que je me rangeais définitivement derrière son regard, qu’il avait raison, que cela ne servait à rien de vouloir donner trop de signification aux choses de la vie.
La réponse de Fabrice était cinglante : « Je n’en crois rien. Je suis sûr que tu es en train de te raconter des histoires ; au fond de toi, tu espères que je vais donner un nouveau sens à ton vide.
— Non, je te jure. Je n’attends plus rien de rien. J’ai changé. »
Fabrice, avec sa précision coutumière, me donnait rendez-
vous dans 112 jours exactement, à 6 h 30 du matin devant la porte principale du Père-Lachaise.
La veille de mon rendez-vous avec Fabrice, en lisant le journal, j’ai compris pourquoi il avait été si précis dans le choix de la date et de l’heure. C’était le moment où allait se produire une éclipse totale du Soleil. Le journal fournissait même des lunettes en carton pour se protéger les yeux.
À l’heure où nous devions nous retrouver, le cimetière était fermé, mais Fabrice possédait les clés de la grille principale. Il m’a emmené en haut d’une butte ; j’ai chaussé mes lunettes.
Après l’éclipse, Fabrice s’est inquiété de ce que j’avais vu.
« Ben, j’ai vu le Soleil tomber dans un trou noir gigantesque.
— C’est ça, tu te racontes toujours les mêmes histoires de monde perdu. Tu n’as pas changé. On t’a dit qu’avec tes lunettes tu allais voir disparaître un astre, et tu l’as cru.
— Mais toi, qu’as-tu vu ?
— J’ai d’abord regardé longtemps dans le vide, puis dans ce vide, j’ai été attiré par le seul élément en mouvement : la Lune. J’ai suivi sa course et, quand elle s’est placée devant le Soleil, je l’ai vue à contre jour, extrêmement douce, d’une blancheur à faire pâlir la banquise. »
C’en était vraiment trop pour moi. J’ai éclaté en sanglots. Ainsi donc, alors qu’elle était là, bien visible devant moi, j’avais encore raté la lune. Une lune historiquement belle. J’entendais le rire de mon frère résonner en moi. Sans même dire au revoir à Fabrice, j’ai quitté le cimetière en me répétant : « Je suis nul, je suis nul, je suis absolument nul. »
Le soir même, en jetant à la poubelle mes lunettes en carton, m’est brusquement revenu en mémoire un tableau que j’avais entr’aperçu lors de l’exposition du Mythe du paradis perdu.
C’était La Vierge au chanoine Van der Paele de Jan van Eyck. Quelque chose me poussait à revoir ce tableau. Comme l’exposition était terminée, je suis allé le retrouver dans son lieu d’origine, au musée Groeninge, à Bruges. J’ai passé un temps infini devant lui. À l’avant-plan, on voit le chanoine Van der Paele retirer ses lunettes pour regarder le divin enfant dans toute sa profondeur. Je ne pouvais m’empêcher d’imaginer que les nombreux détails de la scène, si minutieusement peints par Van Eyck, devaient paraître complètement troubles au chanoine soudain privé de ses lunettes ; que pour percer l’image de la vérité, il avait dû se mettre dans le flou, dans le brouillard, dans le vide.
J’ai voulu trouver le vide idéal entre moi et ce tableau qui me touchait tant. Tout en continuant à fixer la peinture, j’ai fait un pas en arrière, puis deux ; j’ai descendu l’escalier à reculons, je suis allé comme ça jusqu’à la gare. Je suis monté dans le train pour Verviers. Je me suis assis dans le sens inverse de la marche. À ma descente de train, j’ai pris la route de Spa. J’ai marché à reculons jusqu’à notre ancienne maison de campagne. Depuis la mort de ma mère, le jardin était à l’abandon. Il était envahi de bouleaux, d’herbes folles. C’était devenu une forêt, c’était devenu ma forêt des brumes ; celle que je cherchais depuis tant d’années. Là, j’ai enfin senti que je tenais la distance. Dans ce vide que je venais d’ouvrir entre le tableau et moi, un monde avait pris place. Un monde chaotique, un monde de brumes.
C’est cela l’espace de ma vie, c’est ce monde dont je ne saisis pas bien le sens, ce monde perdu entre le regard flou d’un vieux chanoine d’une autre époque et le mien, tout aussi hésitant, un peu flottant, dans la nuit qui tombe.